 Lisez cet article en version anglaise
Lisez cet article en version anglaise- Share this article
- Abonnez-vous à notre newsletter
Pourquoi il faut aller au-delà de la technologie
Les pertes alimentaires continuent de poser d’importants problèmes de nos jours et contribuent à l’insécurité alimentaire, à l’épuisement des ressources (eau, sol et biodiversité), aux émissions de gaz à effet de serre, aux risques pour la santé et aux pertes de revenus, notamment dans les pays à revenus faibles et moyens. Il s’agit-là d’une question systémique et multifactorielle et en l’abordant, on s’engage résolument à résoudre les problèmes liés aux systèmes alimentaires locaux et mondiaux.
La minimisation des pertes alimentaires fait partie intégrante du programme de développement international et constitue un des objectifs de développement durable (ODD 12.3) visant à atteindre, d’ici à 2030, une réduction de 50 pour cent des pertes et du gaspillage alimentaires mondiaux. On considère généralement que l’application de technologies post-récolte en association avec des politiques publiques permet de réduire de moitié les pertes alimentaires, comme indiqué dans le rapport Food in the Anthropocene. À ce jour, les réductions structurelles et durables des pertes et du gaspillage alimentaires restent limitées. Il est important de mettre en œuvre une approche systémique abordant les points suivants.
Évaluation des points de perte et mise à disponibilité de technologies bien adaptées
Il manque souvent une évaluation approfondie des points de perte critiques et les interventions post-récolte pour des céréales telles que le maïs, le blé et le riz, qui nourrissent l’humanité et sous-tendent la civilisation, mettent généralement l’accent sur les interventions de stockage. Toutefois, des pertes post-récolte considérables pourraient avoir lieu avant, par exemple pendant la récolte, le séchage et le battage ou pendant la phase de transformation, et selon le contexte, il pourrait être plus efficace de s’attaquer à ces points de perte.
Les technologies bien adaptées au contexte local sont une condition préalable à la réussite de la mise en œuvre. De nombreux problèmes font surface lorsqu’on fait en sorte que des solutions technologiques telles que des moissonneuses-batteuses, des égreneuses et des séchoirs de taille modeste soient accessibles aux agriculteurs. Souvent, ces machines doivent être importées, sans distributeur local de pièces de rechange et sans capacité d’entretien, sans parler de la formation des agriculteurs à en tirer le meilleur parti.
Dans bien des cas, le matériel ne correspond pas au contexte local ; il offre parfois un rendement très supérieur à ce dont les agriculteurs ont réellement besoin ou à ce qu’ils peuvent gérer. Enfin, certaines innovations en matière de gestion post-récolte nécessitent un matériel d’appoint qu’on ne peut se procurer localement. L’approvisionnement et l’entretien locaux du matériel sont critiques pour la longévité des investissements et pour le travail à plus grande échelle. Ils créent également des opportunités commerciales pour les fournisseurs d’intrants et les prestataires de services.

Photo: Albert Barro/ CNRST, Burkina Faso
La batteuse multifonctionnelle proposée par Green Innovation Center Burkina Faso répond au besoin de réduire les pertes de céréales pendant le battage et au manque de main-d’œuvre pendant les périodes post-récolte, ce qui entraîne des retards de battage et augmente l’altération des céréales. La batteuse (voir photo) peut être utilisée pour différentes récoltes (maïs, sorgho, mil, soja) et est portable. Elle a été mise à la disposition des agriculteurs dans le cadre d’une approche de prestation de services selon laquelle des jeunes des zones rurales sont formés à offrir des services de battage et d’autres services agricoles et post-récolte contre une rémunération en nature ou en liquide.
Les difficultés associées à la durabilité et l’utilisation à plus grande échelle de cette approche incluent les coûts d’acquisition élevés de l’équipement et le manque de financement. La fourniture locale d’instruments financiers facilitant l’accès au crédit ainsi que l’ancrage de cette approche aux administrations locales et aux ONG sont au nombre des solutions potentielles.
Définition de modèles économiques durables pour les innovations post-récolte
L’efficacité économique des investissements post-récolte est essentielle pour les mesures durables et bien ciblées de réduction des pertes. Elle nécessite des modèles économiques durables tenant compte de paramètres économiques quantitatifs clés tels que les coûts d’investissement, les coûts de fonctionnement, les coûts d’opportunité, l’impact des prix, la quantité commercialisable et, éventuellement, la connaissance du degré de réduction des pertes et des points de perte critiques dans la chaîne de valeur. Ce n’est qu’en connaissant le potentiel de création de valeur que les acteurs de la chaîne de valeur feront des investissements ciblés à long terme.
Le pouvoir d’achat des utilisateurs doit être bien pris en compte lorsque l’on planifie l’adaptation des interventions post-récolte pour les petits exploitants agricoles des pays à revenus faibles et moyens. Dans ces pays, les petits exploitants ne disposent généralement pas des ressources nécessaires pour acquérir des technologies.
Les institutions de microfinance peuvent fournir les services financiers nécessaires, mais il est difficile d’y avoir accès en raison des coûts de transaction élevés et de l’absence, chez les agriculteurs, de garanties ou de connaissances financières. Dans ce cas, tout particulièrement, les technologies post-récolte et la nécessité de minimiser les pertes ne sont généralement pas du ressort des financeurs locaux.
Un modèle économique durable pour les innovations post-récolte doit offrir une feuille de route pour la génération de recettes, en tenant compte des difficultés opérationnelles et des impacts sociaux et environnementaux, des divers acteurs concernés et de la façon dont l’innovation peut créer de la valeur pour eux à court et long terme. Dans la phase pilote, il doit inclure la participation des principales parties prenantes et la création d’un environnement favorable à la coopération et au partenariat.
L’entreposage frigorifique solaire est payant à l’utilisation. Il sert à conserver les fruits et légumes (voir également l’article « Résoudre les problèmes de réfrigération grâce au numérique » et est un exemple de modèle économique durable. Les centres de location de machines et les prestataires de services post-récolte ont également prouvé leur efficacité, mais tout modèle économique doit être localement conçu et validé, et en tout état de cause il sera exposé aux fluctuations des marchés locaux et mondiaux.
Les femmes qui transforment les arachides les sèchent généralement à l’air libre, un procédé long et fastidieux nécessitant de la main-d’œuvre et un contrôle constant pour éviter leur exposition aux pluies ou leur contamination par les animaux familiers. Le petit séchoir solaire proposé par Green Innovation Center Togo et distribué par l’intermédiaire des coopératives de femmes (voir photo) répond à ces questions et sèche les arachides quatre fois plus vite que le séchage à l’air libre ; il évite également la contamination par les aflatoxines et garantit un produit de haute qualité.
Cependant, les arachides ainsi séchées ne présentent pas une différence visuellement identifiable (c’est-à-dire valorisée sur le marché) avec les autres arachides et la forte profitabilité de l’appareil reste à démontrer, même si le séchoir réduit les frais de main-d’œuvre. Le plan de durabilité du séchoir inclut la diversification de son utilisation (par exemple pour le séchage des plantes médicinales) et l’offre de services de séchage à d’autres coopératives et à des entreprises privées
Photo: Laré B. Penn/ université de Lomé, Togo
Comprendre la dynamique de marché
Les marchés jouent un rôle primordial dans l’atténuation des pertes post-récolte. La compréhension de la dynamique de marché en association avec une technologie post-récolte – y compris la fluctuation des prix, les liens entre les acteurs des chaînes d’approvisionnement et les préférences des consommateurs – est cruciale pour l’adoption et l’adaptation. Les marchés mal intégrés, notamment les chaînes de valeur fragmentées avec de faibles maillons entre les agriculteurs, les intermédiaires, les grossistes et les détaillants, limitent le volume et la qualité des produits, tout en diminuant les profits et freinant la livraison en temps voulu aux consommateurs.
La coordination entre les acteurs de la chaîne de valeur et l’amélioration des informations sur le marché peuvent attirer les agriculteurs et favoriser la livraison de produits de bonne qualité. L’amélioration des technologies post-récolte peut résoudre ces problèmes mais elle doit être rentable et encourager les investissements associés aux équipements et aux pratiques.
L’établissement de liens entre les petits exploitants agricoles et des créneaux du marché – par exemple, la mise en relation de producteurs mexicains de maïs bleu avec des restaurants gastronomiques de grandes villes, et la garantie de la qualité des grains grâce au stockage dans des récipients hermétiquement fermés, ou encore la diversification du marché et l’application de prix plus élevés pour des produits tels que le maïs exempt d’aflatoxine, lui aussi contenu dans des récipients hermétiquement fermés – sont des stratégies relativement simples pouvant encourager l’investissement dans les technologies post-récolte.
Les solutions technologiques sont un élément clé de la gestion post-récolte, mais leur succès dépend d’une foule de facteurs qui influencent leur adoption, leur efficacité et leur durabilité. Elles peuvent considérablement réduire les pertes et avoir un bon rapport coût-efficacité, mais les parties prenantes potentielles doivent avoir pleinement conscience de leurs avantages et, autant que possible, de leur quantité précise, et par conséquent être prêtes à investir dans ces technologies, à les promouvoir et contribuer à leur développement.
Globalement, pour minimiser les pertes post-récolte, il faut une approche systémique (chaîne de valeur) dans le cadre de laquelle toutes les parties prenantes participent à la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de toute intervention.
Technologies d’entreposage hermétique
Les technologies d’entreposage hermétique, par exemple l’utilisation de sacs ou de silos métalliques hermétiques, désignent des réservoirs étanches d’entreposage des céréales. Tout nuisible (insecte, champignon) infestant les céréales stockées appauvrit rapidement la teneur en oxygène du réservoir et meurt. L’efficacité de ces contenants hermétiques dépend grandement du taux d’humidité du grain (qui doit être inférieur à 14 pour cent au moment de son stockage).
Les petits séchoirs et les humidimètres (tels que la DryCard™, qui comprend une bandelette indicatrice qui, une fois enfermée dans le bocal avec un échantillon de céréales, change de couleur lorsque le grain n’est pas suffisamment sec), ainsi que de bonnes pratiques de séchage à l’air libre et d’autres moyens de contrôler le taux d’humidité du grain, doivent être encouragés parallèlement aux contenants hermétiques. Basée sur les propriétés hygroscopiques du sel (voir photo), la méthode dite « du sel » est un moyen facile de contrôler la teneur en eau.
Utilisation de la méthode dite « du sel » pour contrôler la teneur en eau des grains de maïs : cette méthode consiste à verser 2 à 3 cuillérées de sel séché dans un bocal rempli aux trois-quarts d’un échantillon de grains et à agiter le bocal pendant 2 minutes. Si l’échantillon de maïs n’est pas suffisamment sec (comme à gauche), le sel qui reste adhère à la paroi du bocal ; sinon (comme à droite), le maïs est suffisamment sec et peut être stocké en toute sécurité dans des contenants hermétiques.
Photo: Jessica González/ CIMMYT, Mexico
Sylvanus Odjo est spécialiste post-récolte au Centre international d’amélioration du maïs et du blé (CIMMYT) qui a son siège à Texcoco, Mexique. Il consacre ses travaux au développement et à l’adaptation de technologies et de pratiques post-récolte en Afrique et en Amérique latine. Il est titulaire d’un doctorat en agronomie et en génie biologique obtenu à l’université de Liège, Belgique.
Heike Ostermann est spécialiste post-récolte à la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Elle réside à Bonn, Allemagne, et a une longue expérience de travail sur des projets de développement rural en Afrique. Elle est actuellement chargée de projets aux Centres d’innovations vertes pour le secteur agroalimentaire. Elle est titulaire d’un doctorat en agriculture/ production agricole.
Contact: sylvanus.odjo@cgiar.org
Références
Willett, W. et al. Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. Lancet 393, 447–492 (2019).
Stathers, T. et al. A scoping review of interventions for crop postharvest loss reduction in sub-Saharan Africa and South Asia. Nat. Sustain. 3, 821–835 (2020).
GIZ. Economic Sustainability of Post-Harvest-Investments – Analyses from the Green Innovation Centers, GIZ (2023).



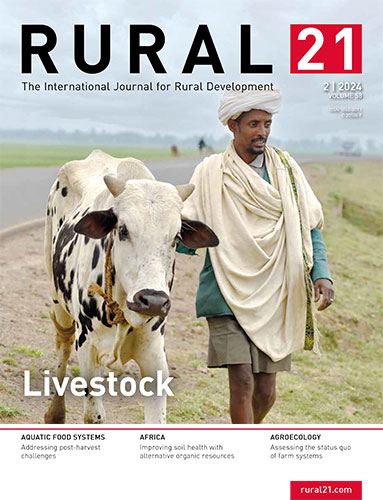

Ajoutez un commentaire
Commentaires :
I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two ifferent internet browsers
and both show the same results. https://Www.waste-ndc.pro/community/profile/tressa79906983/