Wolfgang Mittmann est cofondateur et directeur général de Saving Grains. Il a auparavant travaillé pour la division Innovations et programmes du Programme alimentaire mondial et pour Innovation Accelerator. (Il s’est spécialisé dans le domaine du stockage et du commerce des céréales avec les petits exploitants agricoles.
Photo: Saving Grains 301 GmbH
 Lisez cet article en version anglaise
Lisez cet article en version anglaise- Share this article
- Abonnez-vous à notre newsletter
En ne misant que sur des valeurs sûres, nous laisserons passer de belles occasions
Rural 21: Monsieur Mittmann, comment est née l’idée de Saving Grains ?
Wolfgang Mittmann: Au Programme alimentaire mondial, l’essentiel de mon travail était consacré aux petits exploitants et au commerce des céréales. Et là, j’ai rencontré les mêmes problèmes structurels, encore et encore – problèmes qui empêchent les petits exploitants d’échapper au piège de la pauvreté. Et si certains de ces problèmes peuvent être énormes, d’autres sont également très faciles à résoudre.
Quels sont ces problèmes ?
En Afrique subsaharienne, mais aussi en Asie du Sud et dans de nombreux autres pays, les petits exploitants ne peuvent pas produire à bon marché. Leur production totale est limitée par la faible superficie des parcelles qui les empêche également de réaliser des économies d’échelle. Prenons l’exemple de la mécanisation. Cela coûte souvent plus cher d’aller dans le champ avec le tracteur que de labourer le terrain à la main. Et cela se traduit par des coûts élevés. Au Ghana, par exemple, c’est moins cher d’acheter des céréales sur le marché mondial que de les produire dans le pays.
Cependant, la plupart des pays africains recherchent la souveraineté alimentaire…
C’est un objectif politique et raisonnable que la coopération au développement soutient, et à juste titre. Mais pour l’atteindre, il faut procéder à des transformations structurelles qui sont associées à de nombreux points politiquement sensibles tels que les réformes foncières et les subventions et qui, par conséquent, ne sont pas faciles à mettre en œuvre. Et puis il y a des dilemmes concernant l’objectif visé. Les agriculteurs sont censés augmenter leur production mais il faut éviter de reproduire les erreurs que nous avons commises dans le Nord global, par exemple l’application de niveaux excessifs de produits agro-chimiques, avec les impacts négatifs qu’ils ont eus sur l’environnement et la biodiversité. Et bien que de nombreux projets qui en valent la peine soient menés dans ce domaine, force est d’avouer que les progrès réalisés au cours des dix dernières années n’ont rien d’extraordinaire.
En quoi votre entreprise est-t-elle différente ?
Nous ne voyons pas nos activités sous l’angle de la production, du rendement et du coût, mais sous celui des profits. Ainsi, la marge du petit exploitant, autrement dit le prix de vente moins les coûts, est d’environ 15 pour cent au Ghana. Elle est bien plus faible au Kenya où les agriculteurs produisent pratiquement leurs céréales à prix coûtant.
Pourquoi en est-il ainsi ?
Les agriculteurs vendent à bas prix pendant la récolte. Sur l’ensemble de l’année, le prix des céréales n’est pas si bas que ça, mais il y a d’importantes dynamiques saisonnières. Ainsi, alors qu’en Allemagne les prix fluctuent d’environ deux pour cent, cette fluctuation est d’environ 80 pour cent au Ghana et au Kenya, qui compte deux périodes de végétation, les prix bougent de 50 à 90 pour cent. Les agriculteurs vendent pendant la saison des moissons, si bien que l’offre est très excédentaire et que les prix sont poussés vers le bas et se rapprochent des prix de production. C’est particulièrement le cas pour le maïs et les haricots. Plus tard, les prix remontent progressivement et c’est alors qu’il serait intéressant de vendre, sauf qu’à ce stade, les agriculteurs n’ont pratiquement plus de maïs en stock.
Parce qu’ils n’ont pas d’installations de stockage ?
C’est une des raisons. Si le grain est stocké dans des sacs ordinaires, ce qui est généralement le cas dans les pays qui nous occupent, il est souvent dévoré par les ravageurs du stockage. Les moisissures, elles, produisent des aflatoxines, et c’est une autre histoire. Dans de nombreux pays africains, c’est un énorme problème de santé publique qui contribue à fortement augmenter les taux de cancer du foie et aux retards de croissance chez les enfants. Ainsi, avec le stockage traditionnel, au bout d’un certain temps, l’agriculteur dispose de moins de céréales – la perte de poids se situe autour de 25 pour cent – qui sont en outre de moindre qualité. Par conséquent, comme ils veulent vendre des céréales de bonne qualité, les agriculteurs ne veulent pas les stocker plus longtemps.

Les dommages causés au maïs par les insectes entraînent des pertes qualitatives et quantitatives.
Mais on oublie souvent un autre facteur. Les agriculteurs ont besoin d’argent. La récolte est nécessaire, par exemple, pour rembourser les prêts agricoles formels ou informels et les services fournis à crédit. Mais ce n’est pas tout ; il y a aussi les frais de scolarité. Les agriculteurs sont censés disposer d’argent au moment de la récolte, ne serait-ce que pour payer les prestataires de services. Ils doivent donc, pour cela, vendre une partie de leur récolte.
Comment Saving Grains entend-elle résoudre ces problèmes ?
Nous achetons la récolte des agriculteurs au moment de la récolte et la gardons dans des sacs hermétiques et robustes stockés dans des entrepôts communautaires de manière à préserver la qualité des produits. Nous organisons ensuite, avec les acheteurs industriels, l’enlèvement des sacs lorsque les prix sont élevés. Les agriculteurs reçoivent alors une commission représentant 10 à 20 pour cent du bénéfice. Nous leur offrons donc un service grâce auquel ils obtiennent une part du prix futur des céréales. Au cas où les prix augmenteraient moins que d’habitude, ou s’ils venaient à baisser, la part du bénéfice serait faible ou nulle – mais il n’y aurait toujours pas le moindre risque. C’est-là, bien entendu, un modèle très populaire. Quel agriculteur ne serait pas heureux de vendre son grain sans le moindre risque de marché et, six mois plus tard, toucher à nouveau de l’argent, juste comme ça ? Et comme les problèmes structurels de la plupart des pays d’Afrique subsaharienne sont très similaires, le modèle peut être appliqué à plus grande échelle.
Ça a l’air simple …
Oui, mais la question est de savoir si cela sera suffisant pour sortir les agriculteurs de la pauvreté – promouvoir la santé, l’éducation et tous les autres objectifs de développement durable. Et pour être honnête, non, ce n’est pas suffisant, malgré l’augmentation sensible de la marge bénéficiaire des agriculteurs.
Alors, que faut-il faire ?
Les rendements obtenus par de nombreux agriculteurs représentent toujours un tiers ou un quart de ce que les parcelles pourraient produire. Ici, la coopération au développement a considérablement investi : formations, distribution – par ailleurs non durable – de semences gratuites, subventions pour la commercialisation… Mais de nombreux agriculteurs n’acceptent pas ces offres. Pour comprendre ça, vous devez tenir compte de la situation dans laquelle l’agriculteur se trouve. Si je sème du maïs dans mon champ sans apport d’intrant, mon rendement sera certainement très, très faible. Mais le bénéfice que j’en tirerai ne sera pas si mauvais vu que mes coûts sont nuls. J’aurai peut-être de quoi nourrir ma famille pendant six mois et de quoi vendre quelques sacs pour payer mes dettes.
Maintenant, comparons avec un agriculteur qui investit comme il faut – préparation du terrain, amélioration des semences, engrais, pesticides, technologie de récolte – ce qui est payant en termes de rendement agricole. Mais est-ce que ça rapporte toujours ? Selon notre expérience, souvent ce n’est pas le cas lorsque les prix à la récolte sont bas. Néanmoins, l’agriculteur court un gros risque. S’il ne pleut pas de l’année, en cas d’invasion de sauterelles ou si les plants sont infestés par la légionnaire d’automne, l’investissement considérable est perdu. Les avantages potentiels ne valent pas les risques pris.
Et ça veut dire que les agriculteurs continuent de pratiquer l’agriculture de subsistance ?
Exactement. Ce que nous espérons, c’est que si nous augmentons les profits, les cultivateurs verront que leur seuil risque-profit bascule et que ça vaut la peine d’investir. Pour commencer à voir l’agriculture comme un business, il faut commencer par investir un peu plus, peut-être lutter contre l’érosion du sol ou essayer la rotation des cultures, les cultures intercalaires, etc. Avec une telle approche, à long terme, nous arriverons peut-être à un modèle intégré dans lequel le partage des bénéfices se fera sous la forme d’intrants ou d’une police d’assurance.
Si vous poursuivez cette logique, vous arrivez à un guichet unique encourageant les agriculteurs à augmenter durablement leurs rendements, et à gagner de l’argent. C’est une vision à long terme, et pour le moment, nous sommes heureux de pouvoir payer des parts de profits. Mais nous considérons que les modèles commerciaux axés sur la transformation pourraient résoudre les problèmes sérieux tels que les écarts de rendement et la pauvreté rurale.
Pour en revenir aux pertes post-récolte, pourquoi s’est-il passé si peu de choses ces dernières années ? Est-ce que c’est parce que les technologies manquent de maturité ?
Pour ce qui est des céréales, le problème n’est pas d’ordre technologique. Prenons le cas des sacs hermétiques. Les insectes et les moisissures qui s’y trouvent ont besoin d’air et meurent rapidement. Il n’y a ni perte de poids ni perte de qualité. C’est une technologie toute simple dont on dispose depuis une vingtaine d’années et son efficacité technique est bien documentée.
Et pourquoi ces sacs ne sont-ils pas utilisés systématiquement ?
Les sacs présentent un inconvénient majeur : on ne peut pas regarder dedans. Essayez de m’imaginer en train d’essayer de vous vendre un tel sac de céréales. On ne peut pas l’ouvrir pour vérifier l’état du grain car, une fois ouvert, il ne serait plus hermétique. Devant une telle situation, vous ne l’achèteriez probablement pas. C’est pour cette raison que ces sacs sont essentiellement utilisés pour le stockage à la ferme, afin de nourrir la famille de l’agriculteur. Mais si nous voulons résoudre le problème des pertes alimentaires à grande échelle, nous devons utiliser des sacs hermétiques pour que les céréales suivent l’ensemble de la chaîne de valeur, sans perte à quelque stade que ce soit. C’est précisément pour cette raison que nous élaborons une solution.
À quoi ressemble cette solution ?
Le concept est très simple. Pour commencer, nous avons demandé à nos fournisseurs de nous procurer des sacs transparents. Cela n’a rien d’une innovation sensationnelle. Mais c’est une première étape, qui permet à l’acheteur de voir quelle céréale le sac contient, la couleur, la taille des grains, les impuretés, la présence de pierres, etc. De même, pour écarter tout risque de fermentation dans le sac, fermentation qui dégraderait la qualité du grain, le grain doit être sec. C’est particulièrement important dans les régions dans lesquelles la récolte coïncide avec la saison des pluies.

Les sacs hermétiques transparents permettent aux acheteurs de voir quelle céréale est à l’intérieur. Photo: Wolfgang Mittmann
Comment vous assurez-vous qu’il n’y a pas de fermentation ?
En collaboration avec l’université Humboldt de Berlin et l’Institut Fraunhofer, nous avons mis au point des capteurs qui détectent la fermentation et les dommages causés par les insectes. Les signaux envoyés peuvent être lus au moyen d’une application gratuite qui alerterait l’utilisateur de tout problème de qualité. Ce qui est vraiment intéressant, c’est le fait que comme tout acheteur a intérêt à consulter les capteurs, on peut déterminer l’itinéraire qu’a suivi le sac. Cela est intéressant en matière de gestion de la qualité, mais aussi, et de plus en plus, en ce qui concerne les exigences de la chaîne d’approvisionnement en matière de durabilité sociale – nouvelle loi allemande (Lieferkettengesetz) sur les chaînes d’approvisionnement – ou les exigences des actionnaires ou autres parties prenantes.
Vous pourriez donc garantir la traçabilité…
Oui, et plus encore. L’industrie alimentaire souffre d’un manque de structuration et de prévisibilité de l’approvisionnement en termes de quantité et de qualité. Par exemple, au Ghana, une brasserie peut souvent ne pas savoir si elle pourra remplir ses cuves de céréales locales à prix raisonnable dans les trois mois à venir. Si ce n’est pas possible, elle doit commander l’envoi d’un cargo venant d’Ukraine ou du golfe du Mexique. Avec les « bag data » nous pourrions fournir des informations sur le marché ou agir comme intermédiaire et permettre à l’industrie de mieux planifier sa chaîne d’approvisionnement.
En parlant de qualité, vous avez récemment mentionné les aflatoxines.
La présence d’aflatoxines est le premier critère de qualité de l’industrie alimentaire. C’est particulièrement vrai pour les brasseries ou les « Nestlé » du monde entier et elle est suivie de près par les législateurs. Le Kenya, qui impose des taux très stricts d’aflatoxines et les fait respecter, est le leader dans ce domaine. Ce comportement est positif, bien sûr, mais il crée des incertitudes, pour les fournisseurs, d’une part, qui ne savent pas si leurs produits peuvent être rejetés, et pour l’industrie, d’autre part, qui ne sait pas avec certitude si elle peut se fier aux livraisons prévues. Le rejet de livraisons ne coûte pas directement à une entreprise alimentaire, mais elle pourrait toutefois venir à manquer de matière première.
Là encore, nous sommes à la recherche d’une solution s’appuyant sur la traçabilité. L’aflatoxine est tristement célèbre pour sa grande variabilité, mais sa présence n’a rien d’aléatoire. Elle apparaît à certains endroits, dépend des conditions météorologiques, du traitement post-récolte, etc. Si bien que nous pensons être en mesure de prévoir la présence d’aflatoxines. Cela serait très utile pour le secteur alimentaire, la santé publique et les interventions agricoles.
Comment arriveriez-vous à prévoir les aflatoxines ?
On sait peu de chose sur les facteurs qui déterminent la présence d’aflatoxines dans le contexte des petites exploitations agricoles. Les tests de détection sont coûteux et la forte variabilité de l’aflatoxine peut être source d’erreurs d’échantillonnage. C’est pourquoi elle est si délicate à manipuler. On dispose toutefois d’une multitude de données. L’industrie alimentaire doit déjà effectuer des tests de détection d’aflatoxines. Nous collaborons avec le secteur pour faire en sorte que ces données soient utilisables grâce à l’apprentissage machine. Notre objectif est de mettre au point un système d’alerte aux aflatoxines avec lequel nous pourrions, spatialement et temporellement, prévoir le risque d’aflatoxines. Cela permettrait de prévoir, pour chaque saison, les zones sûres et les zones à grand risques.
Mais pour les agriculteurs concernés, cela voudrait dire ne plus être en mesure de fournir…
Oui, pour le moment. Mais il existe des moyens permettant de réduire les teneurs en aflatoxines, par exemple par décontamination à l’ozone ou au plasma à basse température. À l’aide du système d’alerte, on pourrait cibler les endroits où de telles mesures seraient économiquement justifiées – essentiellement là où les taux d’aflatoxines sont élevés. Bien sûr, il est plus logique de s’attaquer aux aflatoxines là où elles se manifestent. Il existe des solutions pour le traitement du sol, par exemple le produit de biocontrôle Aflasafe, grâce auquel les moisissures aspergillus sont progressivement chassées par d’autres moisissures.
Naturellement, il est très difficile de convaincre les agriculteurs de faire un tel investissement sur plusieurs années, surtout si personne ne se préoccupe de savoir si leurs céréales contiennent des aflatoxines et si le traitement n’apporte aucune valeur ajoutée. Malgré tout, si nous pouvions faire de telles interventions de manière ciblée, cela constituerait un grand pas en avant pour les pertes alimentaires et la santé publique.
Dans quelle mesure pensez-vous que ce système peut s’imposer ?
Nous concevons des systèmes de résolution de problèmes à l’intention de l’industrie et c’est elle qui, en fin de compte, supporte le coût. Nous parlons ici des entreprises du secteur alimentaire se situant au bout de la chaîne de valeur céréalière. C’est-là qu’il y a le siège du pouvoir ; qu’il y a l’argent et que les décisions sont prises. Il est important de parfaitement comprendre leurs processus. Comment la gestion de la qualité est-elle assurée ? Comment est-elle enregistrée ? Les lots font-ils l’objet d’un suivi ? Quels sont les coûts d’un rejet de livraison ? Avec quelle fréquence les taux limites d’aflatoxine sont-ils dépassés dans les produits intermédiaires ou finis ?
Nous devons montrer combien d’argent est perdu et comment notre solution est justifiée d’un point de vue économique. Henning Vogt, notre directeur technique, s’occupe du développement et est persuadé que le coût des capteurs sera de quelques centimes, et que la TI correspondante sera très bon marché avec des volumes conséquents. Ce qui fait que ce système est si attrayant, c’est la valeur créée par les pertes alimentaires évitées, la qualité, la traçabilité et la gestion des aflatoxines.
Le stockage hermétique exige que les céréales soient sèches. Est-ce là quelque chose que les agriculteurs peuvent fondamentalement bien gérer ?
Cela dépend beaucoup de la zone climatique et, bien sûr, du prix. Dans l’ouest du Kenya, par exemple, selon l’altitude, la récolte s’effectue entre août et octobre, en période de sécheresse. Mais dans de nombreux pays et nombreuses régions d’Afrique, le séchage des céréales pose un énorme problème. Par exemple, dans la ceinture moyenne du Ghana, la récolte a lieu en plein milieu de la saison des pluies. À cette période de l’année, les agriculteurs ne peuvent plus sécher leur grain sur une bâche, au soleil. La solution normale consiste à avoir recours à des séchoirs qui ne sont généralement pas disponibles.
Et le séchage coûte cher. Là encore, les agriculteurs doivent trouver une solution : trouver un acheteur pour leurs céréales humides ou gagner plus d’argent en vendant du grain sec. Dans ce cas, il faut mettre en place les installations de séchage dont on a besoin – et c’est-là une question de volume nécessitant de grosses capacités, ce qui veut dire que ce doit être une activité économiquement viable pour l’agriculteur et l’entreprise de séchage.

Dans un village, démonstration de l’application Saving Grains. Photo: Wolfgang Mittmann
Cela fait-il également partie de votre concept ?
Nous disposons d’un séchoir professionnel. Mais la plupart des séchoirs fonctionnent au gazole, au charbon de bois ou au gaz, si bien qu’ils ne sont pas respectueux de l’environnement. C’est pourquoi nous collaborons à la réalisation d’un projet pilote avec le département de génie agricole de l’université des sciences et de technologie Kwame Nkrumah, au Ghana, et avec le Fonds pour la promotion de l’innovation dans l’agriculture, i4Ag. Dans le cadre de cette coopération, nous examinons les séchoirs biomasse afin de voir si nous pouvons les utiliser de manière écologique et économique, et si cela en vaut la peine sous l’angle du cycle des matières. Nous voulons voir si la culture du maïs produit suffisamment de biomasse. Est-ce que les épis et la plante entière fournissent suffisamment d’énergie ? Y a-t-il suffisamment de biomasse aux alentours sans avoir à abattre des arbres ?
Pour quand peut-on attendre les premiers résultats ?
Au Ghana, le séchoir devrait être prêt pour la saison de la récolte, l’année prochaine. Nous l’utiliserons en parallèle avec un séchoir à gazole pour comparer les capacités. Bien entendu, de nombreux autres facteurs devront être pris en compte, par exemple le coût du transport du grain jusqu’au séchoir et le coût de la main-d’œuvre.
Est-il raisonnable d’embarquer les gouvernements dans vos entreprises ?
Nous bénéficions d’un soutien limité. Avec des budgets serrés, et peut-être à juste titre, il est plus tentant pour les gouvernements d’investir dans des produits à haute valeur ajoutée. Pour eux, il est plus important d’exporter pour aider leur économie que de soutenir une petite entreprise qui a de grandes idées. À ce jour, nous n’avons pas vu de possibilités notables de coopérer. Peut-être que ça changera lorsque nous aurons atteint une certaine taille.
Vous avez d’autres partenaires ?
Comme n’importe quelle autre start-up, nous cherchons des investisseurs. Cela vaut tout particulièrement pour l’Afrique et pour les start-ups en phase d’amorçage. Nous avons bénéficié d’une subvention de l’Accélérateur du Programme alimentaire mondial et de l’agence autrichienne de développement et sommes reconnaissant à Bayer pour son don d’entreprise. La Fondation « Deutsche Bundesstiftung Umwelt » a soutenu notre développement technologique. Nous avons signé un plus large accord de partenariat avec la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit et son fonds i4Ag pour une période de trois ans, jusqu’en août 2026.
En tant qu’entreprise sociale, nous cherchons à avoir un impact, mais nous ne pouvons pas, par exemple, organiser des formations d’agriculteurs à grande échelle ou créer de nombreuses infrastructures dans les villages. C’est-là que nous atteignons nos limites. Dans le cadre de ce partenariat, nous bénéficions de l’infrastructure de la GIZ et faisons progresser nos objectifs d’échelle et d’entreprise. Il s’agit donc d’un partenariat mutuellement avantageux et d’une belle opportunité pour nous.
En quoi une entreprise sociale peut-elle faire mieux que la traditionnelle coopération au développement ?
Pour les organisations de coopération au développement, il est naturel d’avoir des objectifs et des processus politiques, ce qui est logique dans un contexte donné. Leur cauchemar c’est que l’argent du contribuable soit détourné et elles élaborent leurs processus en conséquence. Mais ces organisations ne suivent pas les principes de libre marché.
Notre entreprise est axée sur les profits et réduit les coûts au minimum, mais en même temps, elle est guidée par des aspects sociaux où l’impact de chacun est clairement mesuré. Et alors qu’un dollar investi dans la coopération au développement ne vaut jamais qu’un dollar, un dollar investi dans une entreprise sociale peut produire dix, cent, voire mille dollars en performance de transfert, selon l’efficacité avec laquelle le modèle d’entreprise se répand et selon le volume des investissements à faire plus tard.

Recrutement de femmes sur un marché du nord du Ghana. Photo: Wolfgang Mittmann
Mais c’est une vue d’ensemble ; à notre connaissance, aucune agence de développement ne donne de l’argent simplement pour créer une entreprise. Tout est toujours lié à des objectifs et des activités spécifiques. Cependant, je pense que cela explique l’intérêt croissant, de la part de la coopération au développement, à investir dans des start-ups innovantes, des entreprises sociales, des fonds d’investissement et dans l’écosystème plus large des start-ups. 2030, c’est bientôt. Et on est loin d’avoir atteint les objectifs de développement durable. C’est pourquoi nous sommes heureux de coopérer avec les pionniers du fonds i4Ag.
Qu’aimeriez-vous voir se réaliser en ce qui concerne la coopération internationale ?
Un dialogue politique structuré sur ce à quoi devrait ressembler un nouveau type de coopération au développement. Nous devons examiner les risques et notre façon de faire face à l’échec. Si nous parions uniquement sur des valeurs sûres, nous raterons de belles occasions. Voyez les capitaux-risqueurs. Lorsqu’ils apportent des capitaux d’amorçage, ils savent que la majeure partie sera perdue. Quelques-uns vont récupérer leur investissement et un ou deux vont gagner le gros lot et multiplier leur investissement par cent.
Il n’est pas facile de discuter de ça – pouvons-nous investir l’argent du contribuable dans des paris risqués ? Que se passe-t-il en cas de faillite ? Que se passe-t-il en cas de changement de modèle d’entreprise ? Et que se passe-t-il si l’entreprise gagne un tas d’argent alors qu’elle a été financée gratuitement ? Pour la coopération au développement, chaque projet doit réussir. Mais malgré toutes ces réussites, lorsque je parcours l’Afrique rurale, je vois plus souvent de houes que de tracteurs. C’est pourquoi je pense qu’il est temps d’aborder toutes ces questions.
Qu’est-ce qui est important dans un partenariat entre une entreprise sociale et la coopération publique au développement ?
La confiance. La confiance dans le fait de pouvoir travailler et résoudre les problèmes ensemble. La volonté de travailler avec un point focal avec qui on peut parler des vrais défis. Le niveau de liberté qu’autorisent les entreprises. Si l’agence de développement suit la logique consistant à soutenir une entreprise en phase de développement qui a un impact, il est important que les objectifs correspondent. L’agence de développement doit exiger des résultats allant dans le sens de ses objectifs. D’autre part, l’agence de développement et son soutien peuvent de plus en plus écarter la start-up de son activité principale et empêcher le développement souhaité. Il faut trouver un équilibre et l’agence de développement doit être attentive à la dynamique du pouvoir.
Quelle est votre vision à long terme ? Une montée en puissance financée par des investisseurs privés ?
Nous sommes très fiers de notre croissance, mais nous sommes toujours une petite entreprise. Nous nous sommes efforcés d’avoir le bon modèle de sorte qu’il soit profitable, qu’il ait un impact et soit évolutif. Notre troisième cofondateur, Kelvin Tyron, est vraiment le grand spécialiste dans ce domaine et il a déjà fait des dizaines de changements. Notre troisième étape est la reconnaissance par le marché de notre modèle d’entreprise au Ghana et au Kenya. Nous voulons toucher 20 000 agriculteurs. Toutefois, si nous pouvons donner au marché la preuve de notre impact, de nos profits et de notre évolutivité, pourquoi ne pourrions-nous pas faire un bond en avant pour opérer à bien plus grande échelle ?
Il y a des investisseurs à impact, mais aussi des institutions, telles que la Société financière internationale ou la Banque mondiale, le FIDA et des fondations telles que les fondations Rockefeller et Gates. Pourquoi n’investiraient-elles pas massivement dans une solution éprouvée à un problème mondial ? Il y a tellement de fondateurs capables en Afrique – nous pourrions créer des entreprises dans cinq nouveaux pays grâce à un modèle de franchise. Nous pourrions aussi faire entrer des entreprises partenaires, par exemple de grands négociants en grains ou de grandes brasseries, et nous développer dans leurs pas. Une fois de plus, au bout du compte, cela revient à prouver notre profitabilité, notre impact et notre évolutivité. Et il ne nous manque pas grand-chose. Ensuite, tout sera possible. Ensemble nous pouvons résoudre un gros problème à grande échelle !
Le partenariat
Saving Grains 301 GmbH a été créée en 2019 par Wolfgang Mittmann (directeur général), Henning Vogt (directeur technique) et Kelvin Tyron (directeur des ressources humaines/ directeur des opérations). Cette start-up s’est développée à partir de l’accélérateur d’innovation du Programme alimentaire mondial. Son modèle d’entreprise sociale vise à permettre aux agriculteurs de tirer parti des futurs prix des céréales. L’entreprise a récemment commencé à collaborer avec la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dans le contexte du projet de réduction des pertes post-récolte et d’utilisation des résidus agricoles.
Ce projet est mandaté par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ). Il fait partie du Fonds pour la promotion de l’innovation dans l’agriculture (i4Ag) et est réalisé, au Ghana et au Kenya, par Saving Grains au nom de la GIZ. Dans ce cas précis, i4Ag cherche à augmenter la portée et l’impact de la solution. Ses objectifs spécifiques sont notamment l’accroissement de la participation des femmes, l’offre de formation pour une gestion post-récolte élargie et la fourniture d’une infrastructure commerciale aux communautés agricoles.
En novembre 2023, Saving Grains a reçu le Prix allemand de l’entrepreneuriat pour le développement.
Interview: Silvia Richter



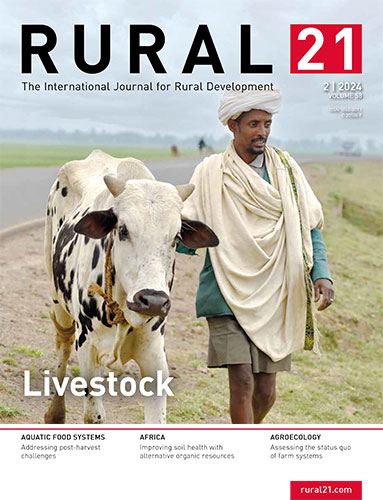

Ajoutez un commentaire
Soyez le premier à faire un commentaire